Guide du solfège pour piano - partie 1
Saviez-vous que les notes de musiques viennent d’un chant liturgique du Moyen-Age ?
Au XIᵉ siècle le moine bénédictin Guido d’Arezzo prend la première syllabe des 6 premiers hémistiches de l’Ut queant laxis (chant honorant la naissance de saint Jean-Baptiste) pour créer les notes ut, ré, mi, fa, sol, la. Ut deviendra par la suite do. Quant au Si, il est issu de la dernière hémistiche et correspond au S de Sancte et au I de Iohannes.
Cette appellation s’est alors démocratisée au point de s’imposer dans les pays de langue romane (France, Italie, Espagne, Portugal) Les pays anglo-saxons ont développé aussi à la même période un système alphabétique de A à G (le la étant A et le G correspondant au sol).
C’est ce qui explique que le mot solfège vient du latin solfa, qui réunit deux de ces fameuses notes : le Sol et le Fa. Ce mot signifie gamme. Assez méconnu, le verbe solfier en est un autre dérivé. C’est le fait de “chanter un morceau de musique en nommant les notes” selon le dictionnaire Le Robert.

1. Le solfège, c'est quoi et à quoi ça sert?
Même si ce n’est pas obligatoire, la musique peut être écrite et lue. Le support qu’on utilise à cette fin est la partition.
Le solfège est un système de notation permettant de figer des idées musicales sur papier. Il recouvre deux aspects :
– le solfège mélodique : on s’intéresse à la hauteur des notes de musique lues sur la portée
– le solfège rythmique.
1.1. Le solfège : un outil doublement utile pour les musiciens
Comparable à l’écriture pour le langage, la partition de musique permet de transmettre, mais c’est également un excellent moyen de mémoriser la musique avec précision.
Le solfège facilite la transmission des idées par l’intermédiaire du support écrit que constitue la partition musicale. Lorsque l’on veut échanger ou jouer avec d’autres musiciens, rien de mieux que de se retrouver autour de la même partition. Cette dernière est même indispensable pour on les grands ensembles tels que les orchestres.
La partition est également un moyen d’organiser et de retenir des idées musicales complexes et leurs nuances d’interprétation sans craindre l’oubli ou la déformation. Pour les pianistes, cela se traduit par un accès facilité et rigoureux au répertoire classique ou plus actuel.
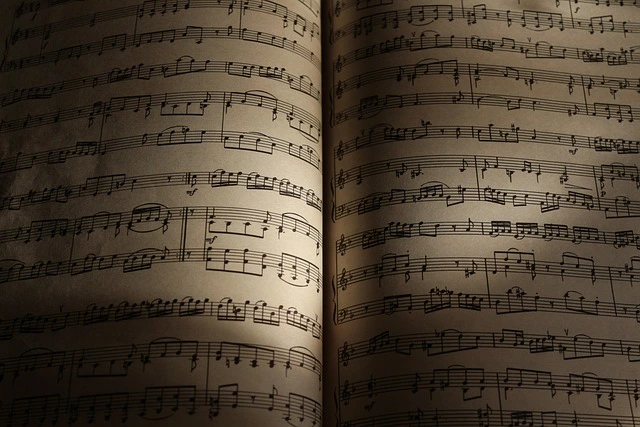
1.2. Le solfège : un outil au service du musicien et non l’inverse
Chez les adultes — et dans une moindre mesure chez les enfants — le mot solfège continue d’effaroucher des générations d’élèves. On imagine qu’il faut d’abord ingurgiter une masse de connaissances arides avant de pouvoir simplement poser les doigts sur un clavier. C’est une erreur. Chez Musicours, nous défendons une approche pédagogique moderne : le solfège ne précède pas la pratique pianistique, il est un rouage. Il est même tout à fait possible de commencer à jouer sans solfège, à condition de suivre une méthode progressive et structurée. Bien utilisé, le solfège reste toutefois une arme redoutable : il permet de gagner en autonomie et, surtout, de progresser efficacement dans l’indépendance des mains — la bête noire de tant de pianistes qui débutent ou sont à un niveau intermédiaire.
1.3. Le solfège reste toutefois qu'un outil
Pour résumer, le solfège désigne la théorie nécessaire à lire et interpréter la musique écrite sur une partition.
Pourtant, nul besoin de support écrit pour faire sonner juste un instrument comme le piano : il suffit simplement de poser ses doigts. Faut-il encore comprendre comment agencer toutes ces notes ensemble pour que ça sonne.
N’est pas Erroll Garner qui veut (pour le piano) ou Jimi Hendrix et Django Reinhardt (pour la guitare). Or, ces trois génies de la musique ont tous trois la particularité de ne pas avoir étudié le solfège avant de faire carrière. Ils maîtrisent par contre leur instrument respectif sur le bout des doigts. Ceci implique un apprentissage théorique et technique de haut vol.
Ainsi, l’étude du solfège peut être nécessaire et bénéfique, mais n’est pas indispensable pour être un bon musicien. Jouer sans partitions implique tout de même la compréhension d’un certain nombre de fondamentaux théoriques, en commençant par des notions basiques (gammes, accords, technique), puis avancées (harmonie, improvisation).
2. Peut-on apprendre le piano sans solfège ?
Est-il possible d’«apprendre le piano sans solfège», d’«apprendre le piano sans jamais faire d’erreur» ou même d’«apprendre le piano sans piano», etc. Aussi absurdes qu’elles puissent sembler, ces idées reviennent paradoxalement plus souvent dans la bouche des adultes débutants que dans celle des enfants. Elles révèlent en réalité une certaine confusion fréquente sur ce qu’implique l’apprentissage d’un instrument de musique.
Parmi ces interrogations, celle d’apprendre le piano sans solfège est sûrement la plus répandue et la moins saugrenue. On trouve effectivement de nombreux contenus en ligne en la matière. Beaucoup jouent cependant sur l’ambiguïté du mot solfège, souvent mal défini dans l’esprit des débutants. Ces derniers assimilent généralement le solfège à un effort purement théorique et abstrait – un obstacle et pour certains une montagne s’opposant à leur clavier. Si c’est aussi votre vision, rassurez-vous : elle est très répandue et il n’y a rien de honteux.
2.1. « Le son avant le signe » : une idée ancienne
Apprendre le piano sans passer d’abord par le solfège, c’est une approche qui, bien que non institutionnellement retenue par les conservatoires en France, s’inscrit dans une tradition pédagogique bien documentée. Dès le XIXème siècle Pestalozzi défend l’idée que l’apprenant doit vivre une expérience avant d’associer les sons à des symboles écrits.
Le principe – «sound before signs» – se retrouve depuis dans de nombreuses méthodes. On peut citer entre autres la méthode Suzuki (méthode de la langue maternelle : écoute, imitation, lecture.) ou les pionniers de l’éducation musicale américains Lowell Mason et Edwin Gordon. E. Gordon affirme ainsi que :
«parce que la musique est un art de l’oralité, il faut d’abord acquérir la perception auditive et la sensation kinesthésique (sensibilité des muscles donnant la notion du mouvement exécuté), (…) le “son” doit être enseigné avant que le “signe” puisse prendre un sens.»
Une étude menée sur trois ans auprès de 101 jeunes musiciens (McPherson et al., 1997) confirme l’intérêt de cette approche. Elle montre que le jeu d’oreille améliore la coordination œil-main-oreille, la perception auditive, et même la lecture musicale à long terme. En clair, l’écoute et la reproduction actives sont des fondements solides sur lesquels construire un parcours musical.
2.2. Jouer du piano sans théorie musicale ?
On l’a bien compris, savoir déchiffrer une partition de musique n’est pas une obligation pour commencer le piano. Pour ne pas risquer de créer des blocages inutiles, il est même parfois préférable de débuter par une approche pratique, en différant toute théorie.
Voici quelques méthodes alternatives :
- le jeu d’oreille : formateur à tout âge et tout niveau;
- l’improvisation : pour les élèves de niveau intermédiaire;
- les méthodes visuelles : schémas, couleurs, vidéos pas-à-pas pour s’initier en douceur, mais sans en abuser;
- l’imitation par les tutoriels vidéos : utiles, mais attention à ne pas en dépendre.
Ces méthodes ne sont cependant valides qu’à court terme. En effet, beaucoup d’autodidactes ou d’élèves peu ou mal encadrés finissent par stagner ou devenir dépendants d’un seul format : tutoriels, vidéos. Il en va de même, d’ailleurs, chez une multitude de pianistes, même aguerris, qui restent prisonniers de leur partition.
2.3. Le piano - sans solfège ≠ sans théorie
Il ne faut pas confondre «sans solfège» et «sans théorie». Même en délaissant le déchiffrage de partition, il vous faudra tout de même vous atteler à développer certaines compétences fondamentales, vous permettant ensuite d’accéder à un jeu pianistique digne d’intérêt.
Quelles connaissances théoriques sont requises pour pratiquer le piano sans utiliser de partition de musique ?
- Savoir reconnaître les notes sur le clavier sans hésitation
- Adopter une bonne posture et acquérir une technique correcte (l’aide d’un professeur en la matière est plus que conseillée).
- Apprendre les gammes majeures et les accords de base.
- S’entrainer à relever des mélodies d’oreille, puis apprendre à construire un accompagnement cohérent.
Ces compétences sont rarement enseignées dans les méthodes simplifiées. Et pourtant, elles ne sont pas si difficile à développer, à condition d’avancer avec une méthode adaptée.
Conclusion :
Il est tout à fait possible d’apprendre le piano sans passer par la case solfège, tant rédoutée par les uns ou sacralisée par d’autres. Toutefois, cette voie ne sera pas plus facile à entreprendre. En effet, une pratique dénuée de support écrit systématique nécessitera également un investissement personnelˆ : ni plus facile, ni plus difficile, simplement différent.
Si l’on décide d’entreprendre l’étude du solfège en tant que débutant, il faut garder en tête qu’il n’est pas forcément nécessaire de l’aborder pendant les premières sessions. Loin d’être inutile, le solfège vous permet par contre d’affronter n’importe quel morceau du répertoire classique ou actuel avec précision et sensibilité, d’être meilleur en rythme et indépendance des mains, et surtout gagner en autonomie dans la pratique.
Une méthode progressive, introduisant le solfège au bon moment, évite de créer des frustrations et divers blocages plus tardifs. C’est cette approche que nous développons chez Musicours dont nous invitons à vous inspirer.
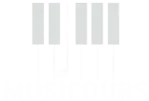
0 commentaires